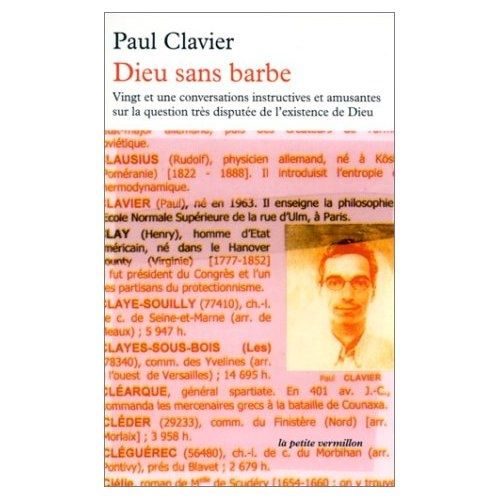 Extrait d’un dialogue entre Théo et Athé, deux interlocuteurs, l’un croyant, l’autre athée, que le philosophe Paul Clavier met en scène dans son remarquable petit ouvrage sur l’existence de Dieu : "Dieu sans barbe" (Editions La Table Ronde, 2002, pages 22 à 24, 42 et 43). Dans ce dialogue, il est question de savoir s’il est légitime pour un croyant de chercher à établir l’existence de Dieu au moyen de la raison.
Extrait d’un dialogue entre Théo et Athé, deux interlocuteurs, l’un croyant, l’autre athée, que le philosophe Paul Clavier met en scène dans son remarquable petit ouvrage sur l’existence de Dieu : "Dieu sans barbe" (Editions La Table Ronde, 2002, pages 22 à 24, 42 et 43). Dans ce dialogue, il est question de savoir s’il est légitime pour un croyant de chercher à établir l’existence de Dieu au moyen de la raison.
THEO : Je trouverais absurde que l’existence de Dieu ne puisse être connue que par la Révélation et doive demeurer inaccessible à la raison humaine.
ATHE : Et pourquoi donc ?
THEO : Suppose qu’il existe un Dieu, créateur de toutes choses, et qu’il ait doté l’homme de raison et d’intelligence.
ATHE : Bon. Supposons. Mais c’est vraiment pour te faire plaisir.
THEO : C’est gentil de ta part. Maintenant, suppose qu’en utilisant correctement cette raison que Dieu lui a donnée, l’homme ne puisse jamais découvrir l’existence de son Créateur. Ou pis encore, que l’exercice rigoureux de son intelligence le conduise à nier Dieu.
ATHE : Ca, je veux bien le croire. C’est tout ?
THEO : Non. Imagine ensuite que ce même Dieu, qui aurait donné à l’homme une intelligence incapable de la connaître, décide de se révéler à lui en personne.
ATHE : Dans un buisson ardent, par exemple ? Au risque de provoquer un incendie de forêt ?
THEO : Si tu veux ! A présent, considère l’homme qui reçoit cette Révélation brûlante. Il se retrouve dans une situation plutôt étrange. D’un côté, Dieu en personne se révèle à lui ; de l’autre, il n’a aucune raison de penser que Dieu existe, et il a peut-être toutes les raisons de penser que Dieu n’existe pas. Plus aucun moyen de coordonner ce qu’il vit avec ce qu’il sait. Stupéfiant, non ?
ATHE : Stupéfiant : c’est le mot. Dieu fait l’effet d’une substance hallucinogène. Et alors ? On dit bien que la religion est l’opium du peuple ! Où est le problème ?
THEO : Le problème, c’est que, dans cette hypothèse, Dieu aurait lui-même fait en sorte d’être ignoré ou même écarté par ceux qui usent correctement de leur raison. Un Dieu qui se suiciderait dans la raison qu’il donne aux hommes : pas très malin, quand même !
ATHE : Ca, c’est son problème ! Ce n’est pas à moi de défendre ce Dieu masochiste. Mais il me semble que s’il existait, il pourrait bien exiger, sinon le sacrifice complet, du moins la soumission de la raison à son autorité. Ecoute ce raisonnement de Pascal : « S’il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque, n’ayant ni parties ni bornes, il n’a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu’il est, ni s’il est ». Simple question de disproportion : notre raison, qui est limitée, ne peut saisir l’être infini de Dieu. En d’autres termes, le Dieu qui se révèle, s’il y en a un, ne sera jamais le Dieu des philosophes et des savants. Il faut donc que la raison se soumette ou se démette !
THEO : Un instant ! Tu veux faire pression sur moi à coup de Pascal ? Eh bien, le même Pascal, si j’ai bonne mémoire, dit également : « La raison ne se soumettrait jamais si elle ne jugeait qu’il y a des occasions où elle doit se soumettre. » Alors, je te pose la question : pour que j’accepte de me soumettre à une Révélation censée venir de Dieu, ne faut-il pas d’abord que j’admette l’existence de Dieu, au moins comme une chose possible ? Car je ne vois pas comment je pourrais accueillir une révélation de quiconque, si je n’ai aucune raison de penser que celui qui se révèle existe objectivement.
ATHE : Puisque l’esprit humain est capable de s’immuniser contre les croyances religieuses, il aurait tort de s’en priver. Pourquoi rouvrir la plaie à peine cicatrisée de la superstition ? Pour risquer une nouvelle infection, peut-être ? Agnostiques et athées ont bien fait, à mon avis, de régler la question de l’existence de Dieu par la suspension ou par la négative. Mais les autres ? Dis-moi quel intérêt y a-t-il, pour le croyant, à considérer d’un point de vue rationnel la question de l’existence de son Dieu ?
THEO : Eh bien, je pense qu’un croyant a tout intérêt à s’assurer que son Dieu existe réellement, et pas seulement comme besoin affectif, comme présupposé éthique ou comme principe d’ordre social. Car il me paraît difficile de faire seulement « comme si » Dieu existait, en demeurant convaincu par ailleurs qu’il n’existe pas ou que nous ne pouvons rien dire de certain sur son existence. Je reconnais que le Dieu des philosophes a peu de choses à voir avec le Dieu des croyants, mais ce peu n’est pas rien. Un escalier de service a peu de choses à voir avec l’intérieur d’une maison. Mais il en commande l’un des accès. D’autres accès sont possibles. Peut-être même y a-t-il un ascenseur. Est-ce une raison pour condamner l’escalier de service ? Le croyant, me semble-t-il, gagne à s’assurer de l’existence de son Dieu en l’absence d’élans de ferveur ou d’élévation mystique. Il est bon de pouvoir s’appuyer, lorsque la ferveur retombe, sur une base de discussion intelligible. Autrement, on risque de s’enfermer dans une forme d’auto-suggestion. Et d’osciller sans fin entre l’absurde et le mystère.


/image%2F1490481%2F20180812%2Fob_64de55_marie-jesus.jpg)